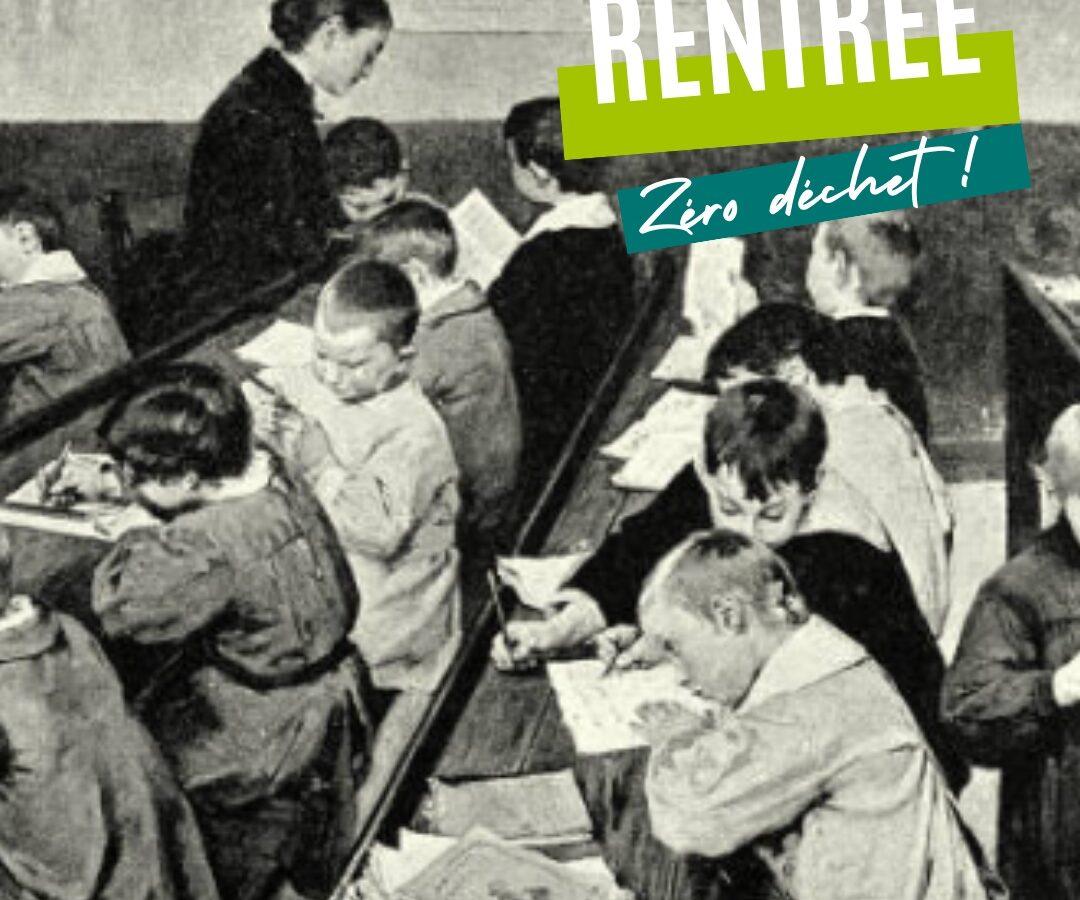Selon une nouvelle étude de l’Université Northwestern, la fraude scientifique organisée est en hausse, des recherches fabriquées aux citations et paternités rémunérées.
En combinant une analyse de données à grande échelle de la littérature scientifique avec des études de cas, les chercheurs ont mené une enquête approfondie sur la fraude scientifique. Alors que les préoccupations concernant les fautes scientifiques se concentrent généralement sur des individus isolés, l'étude de Northwestern a révélé des réseaux mondiaux sophistiqués d'individus et d'entités qui collaborent systématiquement pour porter atteinte à l'intégrité de la publication scientifique.
Le problème est si répandu que la publication de données scientifiques frauduleuses dépasse le taux de croissance des publications scientifiques légitimes. Les auteurs soutiennent que ces résultats devraient servir d'avertissement à la communauté scientifique, qui doit agir avant que le public ne perde confiance dans le processus scientifique.
L'étude sera publiée au cours de la semaine du 4 août dans les Proceedings of the National Academy of Sciences.
« La science doit mieux se contrôler afin de préserver son intégrité », a déclaré Luís AN Amaral , de Northwestern University, auteur principal de l'étude. « Si nous ne sensibilisons pas à ce problème, des comportements de plus en plus néfastes se normaliseront. À un moment donné, il sera trop tard et la littérature scientifique sera complètement corrompue. Certains craignent que parler de ce sujet ne soit une attaque contre la science. Mais je suis convaincu que nous défendons la science contre les acteurs malveillants. Nous devons être conscients de la gravité de ce problème et prendre des mesures pour y remédier. »
Expert des systèmes sociaux complexes, Amaral est titulaire de la chaire Erastus Otis Haven et professeur de sciences de l'ingénieur et de mathématiques appliquées à la McCormick School of Engineering de Northwestern . Reese Richardson , chercheur postdoctoral dans son laboratoire, est le premier auteur de l'article.
Analyse approfondie
Quand on pense à la fraude scientifique, on se souvient souvent d'articles rétractés, de données falsifiées ou de plagiat. Ces reportages mettent généralement en scène les actions isolées d'un individu, qui prend des raccourcis pour progresser dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Mais Amaral et son équipe ont découvert un vaste réseau clandestin opérant dans l'ombre, à l'abri des regards du public.
« Ces réseaux sont essentiellement des organisations criminelles qui agissent de concert pour falsifier le processus scientifique », a déclaré Amaral. « Des millions de dollars sont impliqués dans ces opérations. »
Pour mener l'étude, les chercheurs ont analysé de vastes ensembles de données de publications rétractées, de comptes rendus éditoriaux et de cas de duplication d'images. La plupart des données provenaient des principaux agrégateurs de littérature scientifique, notamment Web of Science (WoS), Scopus d'Elsevier, PubMed/MEDLINE de la National Library of Medicine et OpenAlex, qui inclut des données de Microsoft Academic Graph, Crossref, ORCID, Unpaywall et d'autres référentiels institutionnels.
Richardson et ses collègues ont également compilé des listes de revues désindexées, c'est-à-dire des revues scientifiques retirées des bases de données pour non-respect de certaines normes de qualité ou d'éthique. Les chercheurs ont également inclus des données sur les articles rétractés de Retraction Watch, des commentaires d'articles de PubPeer et des métadonnées (telles que les noms des rédacteurs, les dates de soumission et d'acceptation) d'articles publiés dans des revues spécifiques.
Acheter une réputation
Après avoir analysé les données, l'équipe a découvert des activités coordonnées impliquant des « usines à papier », des courtiers et des revues infiltrées. Fonctionnant comme des usines, les usines à papier produisent un grand nombre de manuscrits, qu'elles vendent ensuite à des universitaires désireux de publier rapidement de nouveaux travaux. Ces manuscrits sont pour la plupart de mauvaise qualité : ils contiennent des données fabriquées, des images manipulées, voire volées, du contenu plagié et parfois des affirmations absurdes ou physiquement impossibles.
« De plus en plus de scientifiques se retrouvent pris dans des moulins à papier », a déclaré Amaral. « Ils peuvent non seulement acheter des articles, mais aussi des citations. Ils peuvent ainsi apparaître comme des scientifiques réputés alors qu'ils n'ont pratiquement pas mené leurs propres recherches. »
« Les papeteries fonctionnent selon différents modèles », a ajouté Richardson. « Nous n'avons donc pu qu'effleurer leur fonctionnement. Mais elles vendent pratiquement tout ce qui peut servir à blanchir une réputation. Elles vendent souvent des postes d'auteur pour des centaines, voire des milliers de dollars. Une personne peut payer plus cher pour un premier auteur, ou moins cher pour un quatrième. Il arrive aussi que des articles soient automatiquement acceptés dans une revue grâce à un faux processus d'évaluation par les pairs. »
Afin d'identifier davantage d'articles provenant des papeteries, le groupe Amaral a lancé un projet parallèle qui analyse automatiquement les articles publiés en science et ingénierie des matériaux. L'équipe a spécifiquement recherché les auteurs ayant mal identifié les instruments utilisés dans leurs recherches. Un article présentant ces résultats a été accepté par la revue PLOS ONE.
Courtiers, détournement et collusion
Amaral, Richardson et leurs collaborateurs ont découvert que les réseaux frauduleux utilisent plusieurs stratégies clés : (1) des groupes de chercheurs s'entendent pour publier des articles dans plusieurs revues. Lorsque leurs activités sont découvertes, les articles sont ensuite rétractés ; (2) des courtiers servent d'intermédiaires pour permettre la publication massive d'articles frauduleux dans des revues compromises ; (3) les activités frauduleuses sont concentrées dans des sous-domaines spécifiques et vulnérables ; et (4) des entités organisées échappent aux mesures de contrôle qualité, telles que la déréférencement des revues.
« Les courtiers mettent en relation tous les acteurs en coulisses », explique Amaral. « Il faut trouver quelqu'un pour rédiger l'article. Il faut trouver des personnes prêtes à payer pour en être les auteurs. Il faut trouver une revue où publier l'ensemble. Et il faut des rédacteurs en chef de cette revue qui accepteront cet article. »
Parfois, ces organisations contournent complètement les revues établies, recherchant plutôt des revues disparues à détourner. Lorsqu'une revue légitime cesse de paraître, par exemple, des individus malintentionnés peuvent s'emparer de son nom ou de son site web. Ces individus usurpent subrepticement l'identité de la revue, conférant ainsi de la crédibilité à ses publications frauduleuses, malgré la disparition de la publication elle-même.
« C'est arrivé à la revue HIV Nursing », a déclaré Richardson. « C'était autrefois la revue d'une organisation professionnelle d'infirmières au Royaume-Uni, puis elle a cessé de paraître et son domaine en ligne a expiré. Une organisation a racheté le nom de domaine et a commencé à publier des milliers d'articles sur des sujets totalement étrangers aux soins infirmiers, tous indexés dans Scopus. »
Se battre pour la science
Pour lutter contre cette menace croissante qui pèse sur la publication scientifique légitime, Amaral et Richardson soulignent la nécessité d'une approche multidimensionnelle. Cette approche comprend un examen plus approfondi des processus éditoriaux, des méthodes améliorées de détection des recherches fabriquées, une meilleure compréhension des réseaux qui facilitent ces pratiques répréhensibles et une restructuration radicale du système d'incitations dans le secteur scientifique.
Amaral et Richardson soulignent également l’importance de s’attaquer à ces questions avant que l’intelligence artificielle (IA) ne s’infiltre davantage dans la littérature scientifique qu’elle ne l’a déjà fait.
« Si nous ne sommes pas prêts à faire face à la fraude déjà en cours, nous ne le serons certainement pas à l'impact de l'IA générative sur la littérature scientifique », a déclaré Richardson. « Nous n'avons aucune idée de ce qui finira dans la littérature, de ce qui sera considéré comme un fait scientifique et de ce qui servira à former les futurs modèles d'IA, qui serviront ensuite à rédiger d'autres articles. »
« Cette étude est probablement le projet le plus déprimant auquel j'ai participé de toute ma vie », a déclaré Amaral. « Depuis tout petit, j'étais passionné par la science. C'est affligeant de voir d'autres personnes frauder et induire autrui en erreur. Mais si vous croyez que la science est utile et importante pour l'humanité, alors vous devez vous battre pour elle. »
L’étude, « Les entités qui permettent la fraude scientifique à grande échelle sont grandes, résilientes et en croissance rapide », a été soutenue par la National Science Foundation et les National Institutes of Health.
JOURNAL
Actes de l'Académie nationale des sciences
TITRE DE L'ARTICLE
Les entités qui permettent la fraude scientifique à grande échelle sont grandes, résilientes et connaissent une croissance rapide
DATE DE PUBLICATION DE L'ARTICLE
4 août 2025
SOURCE : https://www.eurekalert.org/news-releases/1093143